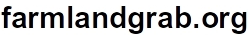Des ouvrières de l’usine de Boteka de PHC – sans équipement de protection – ramassent les fruits épineux du palmier à huile après leur traitement dans l’usine de Boteka. Image: Luciana Téllez/Human Rights Watch.
Des ouvrières de l’usine de Boteka de PHC – sans équipement de protection – ramassent les fruits épineux du palmier à huile après leur traitement dans l’usine de Boteka. Image: Luciana Téllez/Human Rights Watch.Yannick Kenné
- Les communautés riveraines des plantations de la société Plantations et Huileries du Congo (PHC) au nord-est de la République Démocratique du Congo (RDC) revendiquent un peu plus de 58 000 hectares de terres et veulent accéder aux titres fonciers de la société pour connaître les limites de ses concessions.
- Des Institutions européennes de financement du développement (IFD), parmi lesquelles la Banque de développement allemande (DEG), sont accusées d’avoir soutenu financièrement un hold-up foncier de PHC en RDC à travers cette opération, violant leurs propres principes d’accords de prêts.
- Appuyé par une coalition d’Organisations non-gouvernementales, le Réseau d’information et d’appui aux ONG de la RDC a écrit à certains gouvernements de l’Union européenne pour demander la suspension du processus de médiation conduit par le Mécanisme indépendant de gestion des plaintes (MIP) mis en place et soutenu financièrement par les IFD.
- La PHC, également engluée dans une querelle de leadership entre ses actionnaires, est en outre accusée de malversations financières, de crimes environnementaux, et de violation des droits humains dans ses plantations, avec à la clé des arrestations et des détentions arbitraires de travailleurs à la police.
« Les manifestants n’ont pas accepté le fait que M. Patrick Ngoma (responsable de la Garde industrielle de la PHC) puisse installer un originaire du groupe Mwando comme chef d’équipe de la garde industrielle chez-eux du fait que les non-originaires sont sans pitié et les maltraitent », a appris Mongabay auprès d’une source locale à Lokutu.
Selon un communiqué publié sur le site internet de PHC, neuf personnes ont été appréhendées et conduites au poste de police pour être entendues à la suite de cet incident.
Les affrontements entre les communautés locales et les agents de la PHC sont légion dans ses plantations en RDC, et ont même conduit à la mort de certains villageois dans les années passées.
Les communautés riveraines des plantations de PHC revendiquent un peu plus de 58 000 hectares de terres et veulent accéder aux titres fonciers de la société pour connaître les limites de ses concessions. La PHC, propriété du véhicule d’investissement Straight KKM2 (KKM) détenu par Kuramo Capital Management, une société de gestion d’investissement basée à New York, gère plus de 100 000 hectares de terres dans les localités de Lokutu, Yaligambi et Boteka, situées dans la partie nord du pays.
Accusations des violations aux droits humains et à l’environnement.
Les habitants des communautés situées près des plantations de Boteka, de Lokutu et de Yaligimba gérées par Plantations et Huileries du Congo (PHC) ont indiqué que les terres de leurs ancêtres avaient été spoliées par les autorités coloniales belges pour y établir des plantations massives de palmiers à huile.
Réparties sur trois différentes zones, les concessions de palmiers à huile couvrent plus de 107 000 hectares à travers le pays. Les populations locales expliquent que leurs droits à la terre et leurs moyens de subsistance continuent d’être menacés au profit des bénéfices recherchés par la société et les investisseurs étrangers.
Une investigation de Human Rights Watch publié en 2019 fait état de conditions de travail laborieuses et dangereuses pour les ouvriers sous-payés, comme par exemple, une exposition permanente aux pesticides utilisés pour garantir une production intensive des oléagineux. Les déchets des plantations qui se déversent dans les affluents de la rivière Congo soulèvent également des préoccupations. Un autre rapport, publié en 2021 par le cercle de réflexion américain Oakland Institute, a dénoncé plusieurs fondations, fonds de pension et trusts internationaux qui ont continué à financer PHC en dépit des accusations des violations graves aux droits humains et à l’environnement.
Les communautés dénoncent ce qu’elles considèrent comme l’occupation illégale de leurs terres depuis plus d’un siècle, suite à l’acquisition par la multinationale anglo-néerlandaise Unilever, de plantations massives sous l’administration coloniale belge au Congo dans les années 1900.
Le Réseau d’information et d’appui aux organisations non-gouvernementales de République Démocratique du Congo (RIAO-RDC), une plateforme qui regroupe plus de 250 organisations et plus de 330 associations paysannes, s’est engagé depuis quelques années dans la défense des droits des communautés impactées par les concessions.
Jean-François Mombia Atuku, président de RIAO-RDC, a déclaré à Mongabay que les droits des communautés n’ont jamais été respectés depuis l’arrivée de la société Unilever en 1911. « Les terres ont été conquises et jusqu’à maintenant, c’est cet esprit de conquête qui persiste », déclare le défenseur des droits humains.
« Unilever a laissé la place à la PHC. Ces sociétés ont évolué, et nous sommes restés de plus en plus pauvres. Rien ne marche, rien ne va. Pas de routes, pas d’écoles, les travailleurs vivent dans de très mauvaises conditions, et n’ont que des salaires de misère. La stratégie consiste à ne pas recruter les natifs [des communautés locales] dans des postes stratégiques de la société. On ne respecte pas les droits des communautés, on les arrête à longueur de journées. Maintenant, ils se sont accaparés de leurs terres », confie-t-il à Mongabay dans un entretien téléphonique.
Pour Devlin Kuyek, chercheur à l’organisation à but non lucratif GRAIN, le processus de médiation, conduit par le Mécanisme indépendant de gestion des plaintes (MIP) depuis 2020 et soutenu financièrement par les IFD, n’a rien fait depuis lors pour résoudre la question fondamentale d’accaparement des terres ancestrales des communautés de Lokutu, Boteka et Yaligambi.
« Il ne peut y avoir de processus de médiation équitable et efficace de ce conflit foncier sans que les communautés aient au moins accès aux documents officiels de concession foncière et sans qu’elles disposent d’un soutien juridique indépendant pour évaluer ces documents », déclare-t-il dans un courriel à Mongabay. « Les communautés doivent également avoir accès aux documents financiers de l’entreprise des dernières années afin de pouvoir comprendre comment l’argent généré par l’utilisation de leurs terres est dépensé ».
GRAIN était membre d’une coalition d’organisations de la société civile qui a publié un rapport en 2021 sur les investissements au profit de PHC de près de 150 millions de dollars par les plus grandes banques de développement européennes malgré les conflits de longue date opposant l’entreprise aux communautés locales. L’ONG figure parmi les signataires d’une lettre envoyée en avril dernier par une coalition d’organisations de la société civile à des gouvernements de l’Union européenne, pour demander la suspension du processus de médiation, afin de permettre aux communautés d’accéder aux documents fonciers de la PHC qui attestent des limites de ses plantations, et de pouvoir bénéficier d’un soutien juridique pour continuer à défendre leurs intérêts.
Les communautés ont toujours psalmodié l’idée d’une duperie coloniale orchestrée par Unilever pour déposséder leurs ancêtres de leurs terres, et savamment perpétuée par PHC. Parmi des actions engagées pour récupérer leurs terres et forêts, elles ont adressé une plainte à la Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG), la Banque de développement allemande, en 2018, pour dénoncer une facilité de prêt de $49 millions accordée à la PHC par DEG et un consortium de prêteurs européens en décembre 2015.
D’après la lettre, les IFD européennes — DEG, la Banque de développement des Pays-Bas (FMO), la Banque de développement de Belgique (BIO) et le fonds d’investissement Emerging Africa Infrastructure Fund (EAIF) — ont effectué cette opération en violation de leurs propres principes d’accords de prêts qui exigeaient de la PHC qu’elle rétrocède aux communautés environ 60 000 hectares de terres qu’elle n’exploitait pas, comme condition préalable pour l’octroi des $49 millions.
L’information gardée bien secrète par les IFD et la PHC n’a été découverte que récemment par la société civile, qui remet désormais en doute le processus de médiation mené par le MIP.
Le processus de médiation à la croisée des chemins
La DEG s’inscrit en faux contre l’idée d’une suspension du processus de médiation. Elle indique que ce processus bouclé en février dernier, et ayant réuni toutes les parties prenantes y compris RIAO-RDC, est bien avancé dans la recherche des solutions aux plaintes des communautés.
Dans un entretien par courriel au sujet de son soutien financier à la PHC sous l’ère Feronia malgré les accusations de crimes environnementaux et de violation des droits, Barbara Schrahe-Timera, manager corporate communications à la banque allemande, soutient que l’investissement de la DEG s’inscrivait dans le sillage de la valorisation des activités responsabilité sociétale des entreprises du producteur d’huile de palme congolais.
« L’engagement des prêteurs visait notamment à aider à garantir de nombreux emplois dans l’un des pays les plus pauvres du monde, dans des conditions difficiles. En outre, il a permis d’améliorer l’approvisionnement de la population locale en un aliment de base essentiel, ainsi que l’infrastructure sociale sur les sites de plantation », précise-t-elle.
Elle révèle aussi que l’institution financière a rompu ses engagements avec PHC en début 2022, sans pour autant en donner les raisons.
Le MIP a d’ailleurs réagi à la lettre de la coalition des ONG par un communiqué rendu public le 18 avril 2024, et fustige la démarche du RIAO-RDC d’avoir publié précipitamment ce qu’il considère comme un projet de rapport des dernières réunions du MIP, alors que le document n’était pas encore peaufiné. « La publication d’un rapport non public constitue une violation du Code de conduite qui a été signé par toutes les parties et tous les participants à la médiation », dénonce le MIP. Il s’est engagé à produire tout de même un rapport final au mois de mai pour présenter les résultats de la médiation.
La PHC a célébré, le 11 mai dernier, le 113ème anniversaire de sa présence sur le territoire congolais, et se gargarise de performances satisfaisantes au fil des années. Alors que des accusations de crimes environnementaux, de violation des droits humains, de malversations financières et de fraude fiscale restent en suspens, et que ses actionnaires se livrent depuis peu à une véritable guerre des tranchées pour le contrôle de l’entreprise, la PHC révèle qu’entre 2021 et 2024 elle a boosté ses chiffres en matière d’emploi, passant de 6 500 à près de 10 000 employés dans ses plantations et industries. Elle revendique une augmentation de sa production d’huile de palme de l’ordre de 20 % au cours des trois dernières années.
Mongabay a envoyé une demande d’informations à la société pour plus de clarifications sur ces allégations supposées, mais n’a obtenu aucune réponse de sa part.
RETOURS : Veuillez utiliser ce formulaire pour contacter l’auteur de cet article. Pour publier un commentaire public, veuillez vous reporter au bas de cette page.